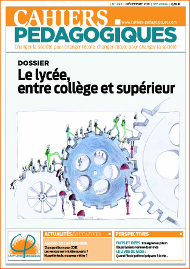Après une conférence dans un collège public proche d'Avranches (Pégase ne craint pas les courses lointaines…), retour à Bordeaux pour la suite de la formation (deux jours, après trois jours en Novembre) de l'équipe d'enseignants de la Seconde spéciale dont j'ai débuté l'accompagnement cette année dans un grand lycée général. Ensuite, troisième stage de l’année avec la classe de seconde méthodo de Toulouse autour du geste de compréhension et de l'autonomie dans le travail intellectuel. Puis nouvelle escapade nordique pour une conférence pour un public très diversifié à l'invitation du Réseau Accompagnement à la Scolarité de la MJC d’Elbeuf en partenariat avec le Réseau d'Éducation Prioritaire local. À l'occasion de ce déplacement, j'ai rencontré (un peu moins de 2 h chacune) deux classes de troisième d'un collège ECLAIR (1), à l'invitation d'un professeur qui utilise systématiquement la gestion mentale dans son enseignement, avec les encouragements de son inspectrice. Nouvelle conférence pour l'Association des Cadres Educatifs aquitains. Puis trois jours de stage avec les élèves de la Seconde bordelaise en présence de leurs enseignants, et enfin une journée avec une quarantaine d’élèves volontaires de Terminale (toutes sections générales et technologiques) de ce même lycée, le premier jour des vacances de printemps.
De la simple conférence pour adultes à plusieurs journées de stage, pour des enseignants ou pour des élèves, en passant par deux petites heures avec des élèves réputés (et réellement…) en difficulté, tout comme ceux de la journée avec les Terminales, à quelques semaines du bachot… Peut-on imaginer géométrie plus variable pour notre monture ailée ? Pendant cette période riche en interventions devant des publics très différents, j'ai pu vérifier une fois encore la pertinence de notre Gestion mentale ainsi que la souplesse de la présentation qu'en permet Pégase.
Bien sûr, en plus des animations visuelles du Power-Point (schémas animés, rouages, tableaux divers…), toutes ces présentations sont ponctuées d'exemples et d’exercices, de quelques uns en conférence rapidement exploités, à des séries plus étoffées dans les stages, toujours suivis de dialogues pédagogiques collectifs de durée variable. La méthode inductive, la « connaissance par l’expérience » et "la preuve par soi" sont toujours la base de la découverte de la GM. Nous sommes bien là dans la «pédagogie éducative » telle que définie par Antoine de LA GRANDERIE (ADLG) dans le chapitre 6 de « Renforcer l’éveil au sens » (p. 83) : l’éclairage donné à l’élève sur les forces qu’il détient et dont il ne soupçonne pas l’existence (2) . Pégase permet donc, malgré les contraintes de temps, de renseigner directement les élèves sur les capacités que détiennent (leurs) activités sensorielles, tout en leur indiquant comment les utiliser dans des projets d’actes aussi conformes que possible aux réalités de leur scolarité. On verra dans leurs témoignages qu’ils emploient à peu près les mêmes mots qu’ADLG pour constater (et déplorer) avec lui que cela n’est jamais ou trop, trop peu souvent, proposé à l’enfant pour qu’il en fasse son profit.
Mais j'entends déjà les critiques : peut-on prétendre diffuser ainsi la gestion mentale et la mettre à la disposition du plus grand nombre en aussi peu de temps ? Ne s'agit-il pas d'un « placage » superficiel au détriment de la prise en compte de la gestion mentale de chacun ? N'est-ce pas réducteur et donc dangereux pour la compréhension en finesse d'une approche aussi riche et complexe de l'activité mentale ?
C'est bien là le problème. Il peut s'énoncer en trois points :
a/ présenter la gestion mentale, dans un temps toujours trop court, et ce de façon suffisamment complète pour ne pas laisser les auditeurs ou les stagiaires « au milieu du gué » par une approche tronquée (évoquer/réactiver/restituer… et quoi après ?) de l'activité mentale ,
b/ en même temps leur permettre de prendre conscience, et si possible d'ébranler et de faire évoluer leurs représentations erronées ou "trop courtes" des enjeux scolaires,
c/ tout en leur permettant de découvrir les potentialités individuelles et la manière de les ajuster à ces enjeux désormais mieux repérés.
En effet, il y a déjà longtemps, je me suis rendu compte que, tout au moins dans le cadre scolaire, la gestion mentale s'épuisait trop souvent à proposer un éclairage sur le potentiel individuel des élèves…, alors même qu’ils ignoraient ou se trompaient lourdement sur les objectifs au service desquels ils tentaient de mobiliser ces capacités mieux reconnues… mais qui restaient du coup trop souvent inefficaces, difficilement transférables…. Avec les déceptions qui ne manquaient pas d’en découler. Quel effet durable pourrait bien avoir une formation à la GM sur des élèves qui resteraient persuadés au fond d’eux-mêmes que le seul objectif de l’Ecole serait de restituer fidèlement au professeur les savoirs reçus de lui ? « Tu sais ta leçon, donc tu dois pouvoir réussir ce contrôle, cet examen… Si tu n’y réussis pas, c’est donc que tu n’as pas travaillé ou alors que tes limites sont atteintes… ! »
Quant aux professeurs, leur proposer, avec quelque chance d’effets durables, un regard aussi individualisé sur leurs élèves, tout en interrogeant, quitte à les déstabiliser quelque peu, leur expérience (leurs propres études, leurs années d’université ou d'enseignement…) et leur modèle pédagogique de référence (le vase vide à remplir..., la pâte à modeler..., l'évaluation de la seule restitution (3)... ) qui sous-tendent inconsciemment leurs pratiques ) … et ce dans l’état actuel de leur formation initiale ou continue… c’est quasi mission impossible…. Est-il raisonnable d'envisager qu’afin que la gestion mentale soit largement utilisée par les enseignants, il leur faille passer plusieurs années en formation ? Mais alors, comment leur présenter cette approche si particulière de la connaissance de façon utilisable, sans déformation majeure, dans les futures Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education (E.S.P.E) quelles que soient leurs appellations à venir ? Sans compter la nouvelle concurrence de la « neuropédagogie », tellement à la mode depuis quelque temps… et relativement plus facile à proposer, sinon à utiliser...
Par ailleurs, la Gestion mentale possède deux visages. D'un coté, une description détaillée des particularités individuelles à l’œuvre dans l’accès à la connaissance : les projets de sens personnels ; de l'autre, un « modèle » de l’apprentissage à base de « lois de la vie mentale » communes à tous et qui constituent les actes de connaissance : les gestes mentaux. Le premier permet à chacun de nous de trouver le sens de son être dans son rapport avec le monde et de le développer, le second de mieux comprendre le sens des études et de s'y réaliser pleinement. Les deux sont étroitement liés, complémentaires. C’est cette complémentarité essentielle, cet équilibre qu’il s’agit de préserver.
C'est donc pour tenter de résoudre le problème d’une diffusion tenant compte des contraintes de temps, sans détruire ce fragile équilibre, que j'ai imaginé le « modèle » Pégase (4) . Depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, il constitue le fil rouge de toutes mes formations, de tous mes stages, et de tous mes entretiens. J’accompagne des équipes de professeurs sur plusieurs années consécutives et je peux constater leur évolution. Elle est réelle. Parallèlement, je parviens à suivre l’évolution de certains des jeunes avec qui j’ai travaillé. Ils réussissent ( et pas seulement scolairement !) de façon satisfaisante… bien plus qu’ils ne l’espéraient avant les stages. J'ai soigneusement enregistré les évaluations formulées par toutes les personnes, enseignants, parents, jeunes eux-mêmes, avec qui j’ai utilisé ce modèle. S’il ne s’agit pas de statistiques scientifiques au sens strict, il s'agit tout de même de plusieurs centaines de témoignages, toujours anonymes pour éviter tous biais de manque de sincérité. Je peux compter sur les doigts de mes deux mains ceux qui contiennent quelques réserves… Mais aucun n'est complètement hostile. J'en ai déjà publié un certain nombre dans « Accompagner… » et dans certains messages de ce blog. Au vu de tous ces résultats et évaluations directes, je peux avancer l’idée que ce « modèle », loin d’être « plaqué », ce qui à coup sûr serait source d’inefficacité et de rejet, produit bien chez jeunes et adultes les effets attendus de la gestion mentale.
J'ai bien sûr récolté une nouvelle moisson de réactions depuis le début de cette année. On retrouve dans les témoignages des élèves les habituels « j'ai repris confiance en moi », « je suis plus motivé(e) pour mon travail », « Ah ! Si j'avais su ça plus tôt »… Mais il y a parfois des détails plus révélateurs de ce qui s'est passé en eux. Les retours des enseignants sont plus variés et approfondis après les deux sessions de formation (j'avais animé une première journée avec les élèves en présence des stagiaires adultes, pour leur montrer la manière d'utiliser certains des éléments transmis). J'extraie quelques passages de ces évaluations, qui présentent quelques notes plus révélatrices.
Enseignants de la classe de Seconde spéciale, auxquels s'étaient joints quelques collègues de collège et de primaire :
« Cinq jours très
enrichissants pour plusieurs raisons :
- j'ai pu approfondir
la découverte de la gestion mentale,
- réflexion sur mes
habitudes de travail et d'enseignement,
- pistes pour utiliser
Pégase en classe avec les secondes mais aussi avec les collégiens,
- je vais me recentrer
sur mon rôle de « facilitateur d'apprentissage » qui est parfois
laissé de côté (temps, programmes). Je considérais déjà
que chaque élève était capable (par la plasticité de son cerveau) de réussir.
Le fait de travailler à partir de cela dans une équipe entière, de se former pour développer cette approche était une
attente de ma part. C'est maintenant fait ! Merci ! »
« Le stage, le contenu
des jours où on était entre nous aussi bien que la journée avec les élèves, a
répondu complètement à mes attentes. J'ai compris ce que vous présentiez, je
cherchais à y mettre un sens et je pensais à des réutilisations pratiques avec
les élèves. Je me sens très stimulée, encore plus enthousiaste. À chaque fois
que j'avais des doutes, je posais des questions auxquelles je recevais des
réponses claires qui faisaient sens pour moi, donc je ne me sens pas déboussolée.
»
« J'étais déstabilisée
par la première partie de formation. J'ai trouvé cela très positif et c'est ce
que j'attendais de cette formation : une remise en question de mes pratiques.
Avec le temps on «ronronne», on fait ce que l'on sait faire, on connaît
nos points forts et on contourne nos points faibles. Cette formation m'a ouvert
les yeux, m'a fait bouger. »
« Après cette
formation, je ressens un ensemble de chocs suite à un sentiment de tremblement
de terre. Certains acquis retrouvent leur place. Par exemple, l'importance du «
pourquoi » dans la compréhension. Je savais déjà l'importance de cette
motivation, mais après la formation je ressens encore mieux sa nécessité. Je
trouve que les schémas sont passionnants ainsi que les exemples car ils
concrétisent et favorisent la mémorisation et la visualisation de
l'apprentissage. »
« Pour l'instant tout reste
encore un peu confus et je ne sais pas ce qu'il en restera dans quelques mois.
Cependant, je retiens l'importance essentielle de préciser le sens de l’enseignement et le projet de l’élève. Je
travaillerai donc d'abord dans ce « sens », en essayant de ne pas me faire trop vite
rattraper par les considérations parasites que sont les programmes à finir, les
notes, être un bon prof… J'ai apprécié que vous vous mettiez en situation avec
les élèves, c'est un risque que prennent peu de formateurs. »
Classes de 3° ECLAIR (témoignages oraux en cours d’un travail d’1 heure trente environ. Je leur ai présenté et fait vivre, avec des schémas et des exercices adaptés, les trois grands "moments" de leur "métier d'élève": comprendre les informations reçues en classe, les conserver durablement, les retrouver "au bon moment" dans les contrôles).
Hamza : « je me rappelle, un jour en sortant de classe, je savais tout. Sans le faire exprès, j'avais fait dans ma tête ce que vous venez de nous montrer. C'est vrai que ça marche ! ».
Soukaina : « j'ai réalisé que je peux faire des schémas dans ma tête pour mieux comprendre. Ça va beaucoup m'aider. »
Princeton (témoignage extra-scolaire sollicité par moi pour introduire le geste de mémorisation) : « Je me souviens, au football, notre entraîneur nous a montré comment il fallait se placer pour recevoir le ballon et pour pouvoir le passer à nos camarades. J'écoutais ce qu'il disait et en même temps j'imaginais que je le faisais sur le terrain dans le prochain match. » Outre l'essence même du geste mental de mémorisation (vivre son avenir de réemploi dans son présent d'apprentissage), ce jeune nous fournit une excellente métaphore du juste "positionnement" de l''élève : recevoir et "traiter" des objets de savoir en les destinant par avance à des utilisations futures et à une bonne communication avec "les autres" en bout de chaîne... On a là en réduction toute la dynamique de Pégase. Merci Princeton pour cette image très révélatrice du véritable "sens du jeu scolaire" ! Sans le savoir clairement, ces jeunes possèdent en eux les moyens de leur propre réussite : les forces qu’il détien(nen)t et dont il(s) ne soupçonne(nt) pas l’existence. Encore faut-il les aider à s'en rendre compte... sans trop compter sur le hasard. Cela ne contribue-t-il pas fortement à une meilleure égalité des chances ?
Classe de Seconde de Lycée général à Bordeaux, après trois jours et demi autour de Pégase (quelques témoignages écrits, anonymes et particulièrement représentatifs sur une trentaine ) :
« Si j’avais su cela avant, j’aurais sûrement mieux réussi mon collège ».
« Cela fait plusieurs mois que je me posais énormément de questions. J'ai enfin toutes les réponses. Tout ce que j'ai appris durant ces trois jours me servira beaucoup. Je me sens bouleversée, je ne pensais pas que d'autres personnes se posaient les mêmes questions, par exemple : pourquoi y a-t-il des élèves qui réussissent et d'autres non ? Pourquoi apprendre sans comprendre ? Ce stage est précieux et tout le monde devrait le faire. »
« Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur mon cerveau, sur sa capacité à emmagasiner les choses. Cette formation de gestion mentale était bien. On a fait beaucoup d'exercices et c'est ce qui nous a permis de mieux comprendre ce que vous disiez. »
« Je pense que la formation s'est révélée utile en ce qui concerne le fonctionnement personnel de notre cerveau et les problèmes ou les mauvaises habitudes prises par lui, par exemple pour apprendre les leçons. »
« Après (cette) formation avec vous, je suis contente d'avoir pu mettre des mots, des phrases sur mes raisonnements, d’avoir pris conscience de ce que je fais au lycée. Je pense que cette année j'avais déjà trouvé mon système d'apprentissage, mais vous m'avez aidé à en donner le sens. »
Volontaires de Terminale après une journée (quelques-unes des évaluations écrites anonymes):
« Cette journée a été très intéressante. En effet, durant notre scolarité de nombreux conseils nous sont donnés mais en désordre et non expliqués. Je trouve ça inutile, autant ne rien dire. Cette journée permet de structurer notre tête, cela est plutôt pas mal. »
« Pour moi, cette journée m'a permis de découvrir les outils de la réflexion. Cette journée, je pense, a été nécessaire et aurait dû être faite plus tôt. J'aurais aimé qu'elle soit plus longue mais je suis très contente d'y avoir participé et de m'avoir ouvert les yeux sur mes erreurs que je vais éviter de refaire. »
« Cette journée a été très intéressante car cela m'a appris comment vraiment travailler, avec quelles méthodes et quels outils de réflexion, chose que nous n'avons jamais appris auparavant, ce qui est bien dommage.»
« C'était vraiment sympa et enrichissant. Le travail sur la réflexion de comment fonctionne la mémoire a été intéressant car on ne nous explique pas cela dans l'éducation moderne. »
« Aujourd'hui, j'ai trouvé cette formation très intéressante car j'ai pu apprendre beaucoup sur la manière de travailler et je me suis rendu compte que finalement avec des méthodes (les évocations) que l'on connaît mais qu'on ne met pas en pratique, ou qu'on ne prend pas le temps de mettre en pratique, cela devient beaucoup plus simple. Grâce à vos explications, je vais pouvoir mettre en pratique pendant les cours du lycée mais aussi pour plus tard car maintenant que je sais, ça me servira toute ma vie.»
Et enfin celui-ci qui me touche plus personnellement : « Cette journée a été très intéressante. Elle m'a permis de mieux comprendre comment appréhender les différents problèmes et comment bien réfléchir : ce que l'enseignement oublie de nous apprendre. Je vais réutiliser votre schéma sur la compréhension des énoncés et les problématiques, je vais aussi essayer d'utiliser la technique de se remémorer le travail fait en fin d'heure. Merci de votre intervention, continuez comme cela, il faut plus de gens comme vous ! »
Même si je sais bien que "Pégase", bien qu'approuvé et encouragé par ADLG (5), n’est pas le tout de la Gestion mentale, au moins permet-il de la proposer à des cercles élargis du coté du monde scolaire, avec des résultats probants, et surtout, il donne envie à ceux qui y ont goûté d’aller plus loin. Finalement, n'est-ce pas ce qu'on lui demande ?
Notes.
(1) réseau ECLAIR : Ecole Collège Lycée Ambition Innovation Réussite.
(2) Bien plus que les exercices (en formation) ou les tâches (en classe) auxquels on invite les élèves et qu’ils faut bien sûr choisir avec soin , ce qui compte vraiment pour la bonne transmission de la GM comme pour celle des contenus scolaires, c’est la manière dont on amène les jeunes (tout comme les adultes…) à « abstraire » du concret de ce qu’ils viennent de faire, l’enseignement qui y est contenu, les structures mentales qu’ils ont investies dans leur travail et qu’ils peuvent faire revenir à leur conscience : leurs forces insoupçonnées. C’est là le rôle du Dialogue Pédagogique, collectif en stage ou conférence, individuel en entretien, qui doit toujours suivre ces moments d’activité. Et c’est la seule manière de pratiquer cette « pédagogie éducative » dont Pégase se réclame explicitement.
(3) Voir message 24 et page spéciale :"Pédagogie du sens, sens de la pédagogie"
(4) … et non la « méthode » Pégase comme je l'entends ou le lis parfois… Cette déformation linguistique n'est pas neutre ! Un modèle permet de rendre compte d'une façon simple d’une réalité complexe, ce qui est bien le cas de la Gestion mentale. Simplification n'est pas simplisme ni réduction. Une méthode se rapproche davantage d’une procédure à mettre en œuvre… sans forcément en connaître les dessous et les enjeux réels. Dans "Accompagner..." j'ai effectivement donné des pistes d'application des concepts de la Gestion Mentale, mais ces "comment peut-on faire" n'étaient que des exemples et ils complétaient toujours des explications détaillées du "pourquoi" et du "pour quoi le faire" de ces procédures.
(5) La belle préface écrite par Antoine de LA GARANDERIE pour "Accompagner..." , livre dans lequel Pégase est présenté de façon très détaillée, ne laisse guère de doute sur cette approbation tout à fait explicite.